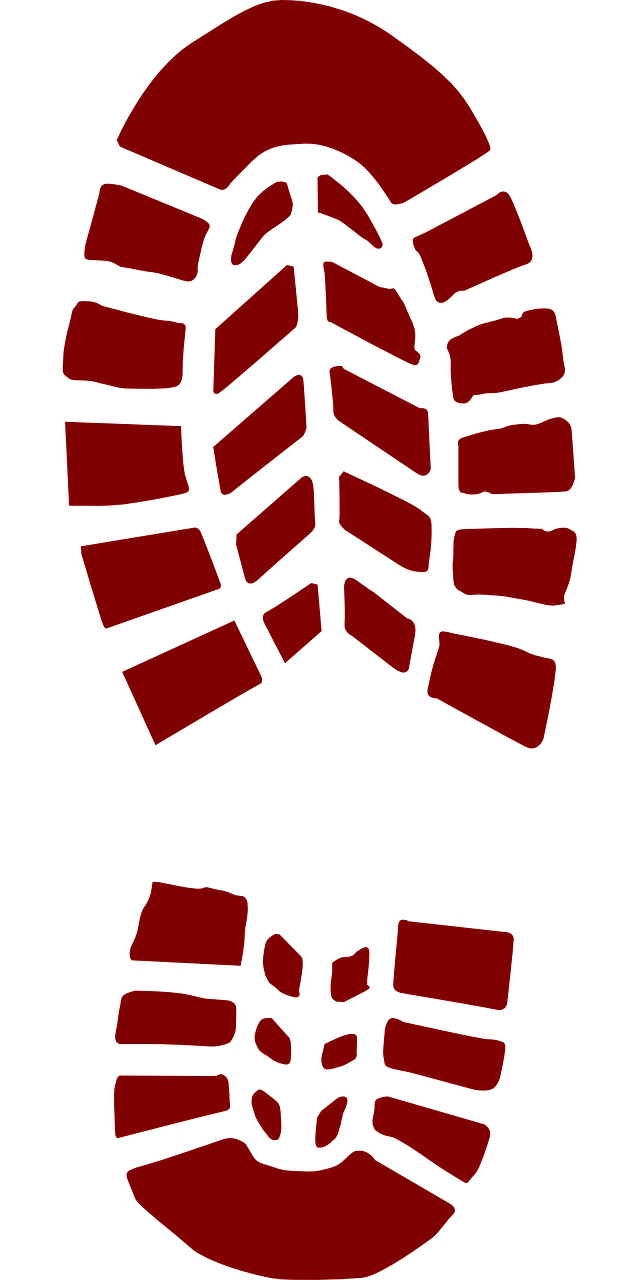|
EN BREF
|
Depuis l’introduction du bilan carbone en France il y a vingt ans, cet outil a permis de populariser la comptabilité carbone au sein des entreprises. Cependant, son utilisation demeure limitée, avec seulement un tiers des obligés respectant l’exigence légale d’évaluation régulière de leurs émissions de gaz à effet de serre (GES). Malgré des lois telles que la loi Grenelle II, le manque de sanctions a conduit de nombreuses entreprises à négliger cette obligation. Les évaluations montrent une augmentation continue des émissions, ce qui soulève des questions sur l’efficacité du bilan carbone en tant qu’outil de décarbonation. L’inventaire des émissions est divisé en scopes, dont le scope 3, souvent omis par les entreprises, représente des sources d’émissions significatives sur lesquelles elles ont peu d’influence. La nécessité d’une transition vers des produits plus durables et d’une réduction effective des émissions devient donc cruciale.
Depuis l’introduction du bilan carbone en France, deux décennies se sont écoulées, marquées par des avancées significatives mais aussi des limites notables dans la quantification et la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES). Cet article se propose d’explorer l’évolution du bilan carbone, ses implications pour les entreprises et les collectivités, ainsi que les pistes d’amélioration et d’avenir dans la lutte contre le changement climatique.
Les origines du bilan carbone
Le concept du bilan carbone trouve ses racines dans les accords internationaux sur le climat, tels que le protocole de Kyoto signé en 1997, qui oblige les pays industrialisés à réduire leurs GES. À cette époque, la difficulté de quantifier le carbone a entraîné des efforts de recherche pour établir des outils d’évaluation efficaces. Des ingénieurs et des chercheurs ont commencé à travailler sur des méthodes mesurables pour optimiser et réduire les émissions à travers des analyses de cycle de vie (ACV).
Le développement de l’outil bilan carbone en France
Créé avec le soutien de l’Ademe, le bilan carbone a été mis en œuvre en 2004, mais son adoption a été limitée par le manque de formations et d’outils adaptés. Bien que cet outil ait popularisé la comptabilité carbone auprès des entreprises, son utilisation est restée inégale. Les disparités entre secteurs d’activité et les écarts de moyens techniques restent des défis importants à surmonter.
Un panorama international du bilan carbone
Alors que la France peinait à déployer son outil, d’autres pays, en particulier ceux du monde anglo-saxon, avaient déjà amorcé des approches similaires. Le GHG Protocol, pilier de la comptabilité carbone, a vu le jour bien avant son équivalent français, soulignant la nécessité pour la France de rester compétitive sur le plan international. À l’heure actuelle, 97 % des entreprises composant l’indice S&P 500 appliquent la méthode du GHG Protocol, tandis que le bilan carbone reste bien moins utilisé dans certaines sphères économiques en France.
Les obligations légales des entreprises
La loi Grenelle II, adoptée en 2010, a instauré des obligations légales pour les entreprises et collectivités à réaliser des bilans de leurs émissions. Cependant, le faible taux de conformité de ces obligations, avec seulement un tiers des assujettis ayant publié leur bilan régulièrement, met en lumière les failles du système. Lorsque l’application de cette loi est un poids cadre, de nombreuses entreprises continuent d’échapper à leur responsabilité légalement définie.
Les enjeux de la comptabilité carbone
Le bilan carbone soulève plusieurs enjeux, notamment la responsabilité des entreprises dans la réduction de leurs émissions. Pour de nombreuses sociétés, la comptabilité carbone constitue avant tout un exercice formel, éloigné des intentions réelles de réduction. Le constat est préoccupant : deux décennies plus tard, les émissions de GES continuent d’augmenter, suscitant les inquiétudes de nombreux experts sur l’efficacité réelle des outils mis en œuvre.
La question des scopes dans les bilans carbone
Dans le cadre de l’évaluation de leur empreinte carbone, les entreprises sont souvent confrontées aux différents scopes d’émissions. Ceux-ci se déclinent en trois catégories : les émissions directes (scope 1), les émissions liées à la consommation d’énergie (scope 2) et les émissions indirectes du champ d’action général (scope 3). Faute d’un engagement sur le scope 3, qui englobe les émissions des chaînes d’approvisionnement et l’usage des produits, de nombreuses entreprises omettent d’embrasser une vision globale de leur impact environnemental.
Un outil controversé pour la décarbonation
Le bilan carbone, bien qu’il ait engagé une certaine dynamique, est devenu controversé en tant qu’outil de décarbonation réelle. La précarité de ses résultats, parfois imprécis, appelle à une réflexion plus large sur les mesures effectives à prendre pour voir un changement palpable en matière d’émissions. Plusieurs acteurs du secteur, dont des directeurs de développement durable, soutiennent que ce tableau de bord seul ne pourra jamais amener à une réduction significative de l’empreinte carbone sans un revirement plus audacieux dans la production et la consommation.
Les perspectives d’avenir pour le bilan carbone
À l’aube de nouvelles décennies, la question se pose : comment rendre le bilan carbone plus efficace et pertinent ? Plusieurs pistes sont envisagées, telles que l’intégration de systèmes d’évaluation plus granuleux, la mise en avant des innovations technologiques, et l’élargissement de la sensibilisation des acteurs économiques aux enjeux climatiques. Par ailleurs, l’accent doit être mis sur des pratiques de consommation durable et des choix éclairés pour permettre une vraie transition vers un modèle économique responsable.
Au regard des deux décennies écoulées, le bilan carbone a permis de poser les bases d’une mesure des émissions de GES en France. Cependant, force est de constater que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour provoquer un changement structurel significatif dans la manière dont les entreprises et collectivités abordent leurs impacts environnementaux.
Liens et ressources supplémentaires
Pour une compréhension plus profonde et précise des enjeux liés au bilan carbone, les lecteurs sont invités à consulter les études et analyses détaillées sur ces sujets via les liens suivants :
- État des lieux du bilan carbone : La France stagne face aux enjeux environnementaux.
- Vingt ans après : un état des lieux nuancé sur l’empreinte carbone et son impact sur le changement climatique.
- Deux décennies plus tard : un état des lieux nuancé face à la lutte contre le changement climatique.
- Deux décennies plus tard : un état des lieux sur l’empreinte carbone et la lutte contre le changement climatique.
- Bilan carbone : un paramètre essentiel dans l’analyse du cycle de vie.
- Enjeux et perspectives du bilan carbone pour 2030.
- Deux décennies plus tard : un état des lieux nuancé du bilan carbone face aux défis du changement climatique.
- Les avantages d’un bilan carbone pour attirer de nouveaux clients.
- Le rôle des startups dans la réduction du bilan carbone.
- Trump plaide pour une exemption des industries polluantes du cadre de bilan carbone.

Depuis son introduction en 2004, le bilan carbone a connu un cheminement complexe en France. Michèle Pappalardo, ancienne présidente de l’Ademe, se remémore cette époque avec un regard critique. « Le carbone n’était pas une chose très concrète. On ne savait pas du tout le mesurer », déclare-t-elle. Ce manque de méthodologie a grandement freiné les initiatives d’évaluation des émissions de gaz à effet de serre.
Stéphane His, consultant en stratégie carbone, partage son point de vue : « Incontestablement, cet outil a popularisé la comptabilité carbone, notamment au sein des entreprises. » Toutefois, il souligne que cette popularité est relative. Bien que de nombreuses entreprises aient intégré cet outil dans leurs pratiques, beaucoup d’entre elles se contentent d’une obligation légale sans réelle intention de réduction significative des émissions.
Les chiffres sont sans appel. Selon l’Ademe, seul un tiers des entités assujetties à l’obligation de bilan carbone a régulièrement publié ses données d’émission. Renaud Bettin, vice-président action climatique de Sweep, exprime une inquiétude croissante : « Voilà vingt ans que l’on évalue les émissions des entreprises et des collectivités, et les émissions continuent de progresser. » Cette déclaration choque, car il semble que les efforts menés n’aient pas porté leurs fruits en matière de réduction des GES.
Les entreprises semblent souvent laisser de côté le scope 3, qui inclut les émissions indirectes provenant de leurs activités amont et aval. Michèle Pappalardo l’explique ainsi : « Beaucoup d’entreprises ne prennent pas en compte ce scope sur lequel elles n’ont pas beaucoup de leviers d’action. » Cela soulève la question de la crédibilité et de l’impact réel de leurs efforts de redressement environnemental.
Fabrice Bonnifet, directeur développement durable et qualité-santé-environnement du groupe Bouygues, semble pessimiste sur la capacité du bilan carbone à amorcer une véritable décarbonation. Selon lui, « les chiffres d’émission des entreprises souffrent d’une très grande imprécision. » Il insiste sur le fait que, pour réussir à réduire les émissions, les entreprises doivent adopter des pratiques plus durables. « La seule solution, c’est de produire moins et de ne plus fabriquer que des produits durables », conclut-il.
Face à ce bilan contrasté, alors que certaines entreprises s’efforcent de respecter les standards internationaux, la France peine à rattraper son retard. Les défis restent nombreux pour intégrer efficacement l’outil dans les stratégies à long terme, tant au niveau économique qu’environnemental.