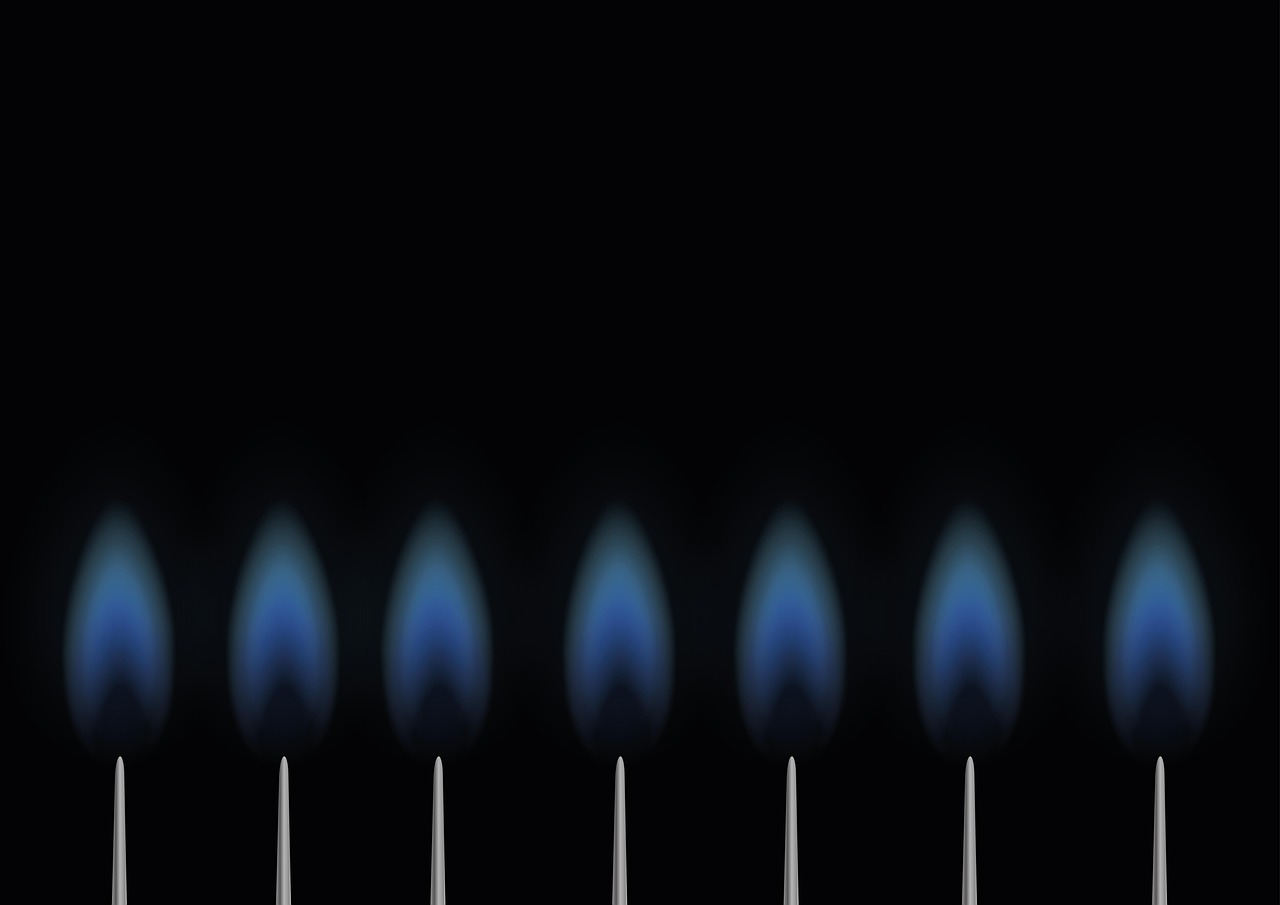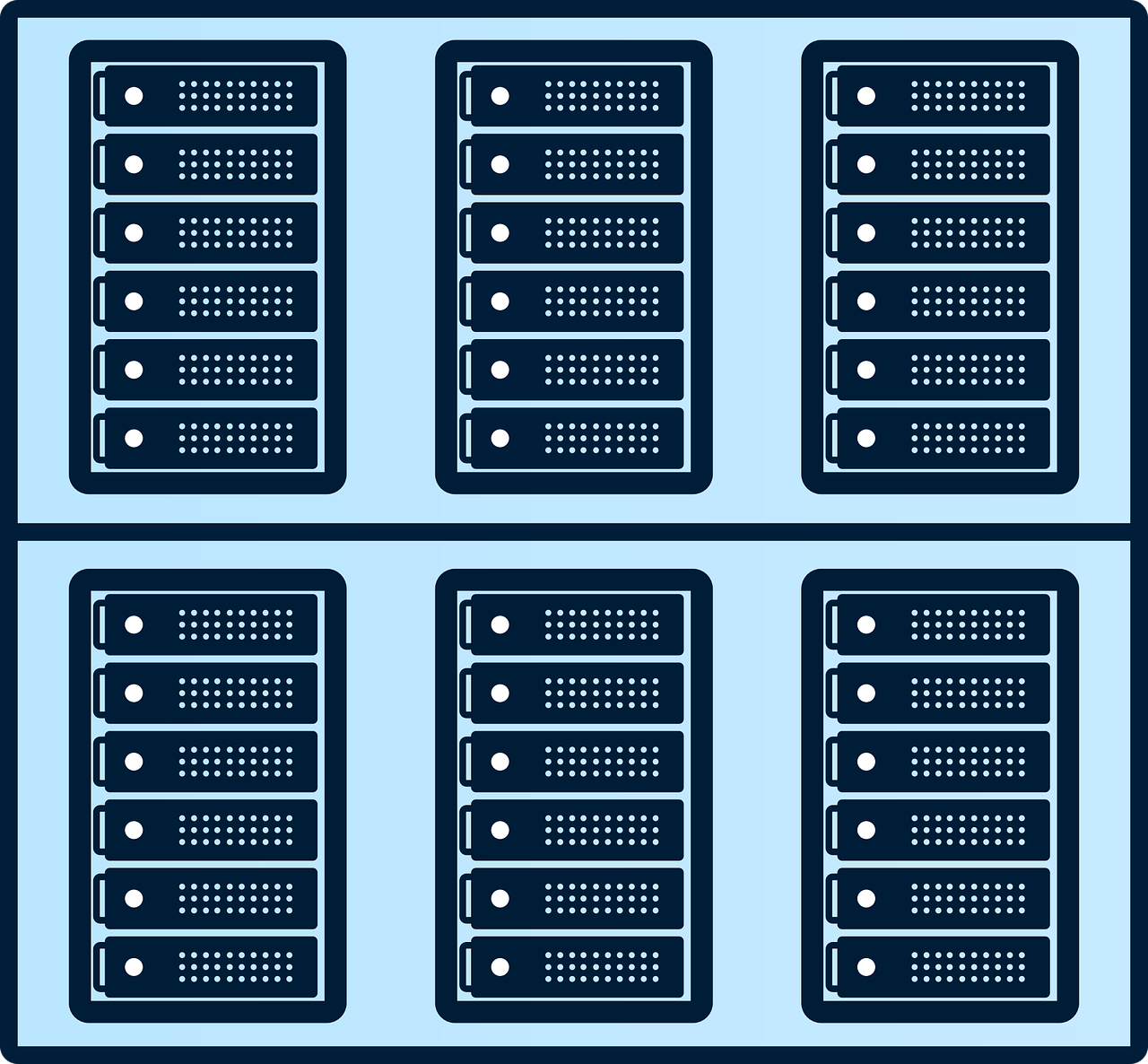|
EN BREF
|
Les émissions cumulées du football et du rugby en France atteignent 2,2 millions de tonnes de CO2 par an, selon une étude du Shift Project. Cette analyse, financée par la Maif et réalisée sur deux ans, prend en compte des données relatives aux déplacements pour les entraînements et les matchs, aux ventes de nourriture lors des événements, ainsi que la consommation énergétique des infrastructures. Il est révélateur que le football, comptant 2 millions de licenciés, est responsable de 62 % des émissions de gaz à effet de serre, tandis que le rugby, avec moins de pratiquants, représente 38 %. Les déplacements, qui sont la principale source d’émissions, témoignent d’une forte dépendance aux énergies fossiles, avec 75 % des trajets en voiture pour le sport amateur et un usage important de l’avion pour les événements professionnels. Le rapport propose diverses pistes pour réduire l’impact environnemental de ces sports, notamment en optimisant la mobilité et en adoptant des infrastructures plus durables.
Dans le contexte actuel où la lutte contre le changement climatique est devenue une priorité pour de nombreux secteurs, il est essentiel d’évaluer l’empreinte carbone des activités humaines, y compris celles liées aux sports. Cet article s’intéresse particulièrement à l’impact écologique du football et du rugby en France. Une étude récente du Shift Project révèle que ces deux disciplines, qui cumulent près de 2,2 millions de licenciés, génèrent des émissions importantes de CO2, équivalentes à celles d’une ville de taille intermédiaire. À travers cette analyse, l’objectif est de comprendre les différentes sources d’émissions de ces sports et d’explorer des pistes pour réduire leur empreinte carbone.
Les chiffres clés de l’empreinte carbone
Selon le rapport « Décarbonons le Sport – Un premier applicatif au football et au rugby » du Shift Project, les émissions cumulées de ces deux sports équivalent à 2,2 millions de tonnes de CO2 par an. Cette estimation tient compte des données recueillies auprès des fédérations sportives ainsi que des ligues professionnelles et amateurs. Les auteurs de l’étude, ayant observé des aspects variés tels que le nombre de kilomètres parcourus pour se rendre aux matchs ou aux entraînements, ainsi que la consommation d’énergie des infrastructures, permettent d’établir un bilan carbone complet. Ces données vestimentaires deviennent alors cruciales pour appréhender l’impact environnemental de ces deux sports, tant sur le plan professionnel qu’amateur.
Comparaison des impacts entre football et rugby
Une des conclusions majeures de l’étude est le constat que le football représente une part prépondérante des émissions de carbone liées aux sports collectifs en France. En effet, avec presque 2 millions de licenciés, le football est responsable de 62 % des émissions, contre 38 % pour le rugby, qui compte un nombre de licenciés nettement inférieur. Cette situation s’explique par la plus grande popularité du football et la fréquence plus élevée des matchs. De plus, en observant l’empreinte carbone par joueur, il est à noter que les athlètes professionnels en football émettent 25 à 30 fois plus de CO2 que les pratiquants amateurs en raison de leurs déplacements éloignés, souvent en avion ou en car.
Les sources d’émissions
Les déplacements constituent la première source d’émissions de carbone dans le milieu sportif. En effet, près de 50 % des émissions totales proviennent des déplacements des sportifs et des spectateurs. Dans le sport amateur, environ 75 % de ces trajets se font en voiture, ce qui témoigne d’une forte dépendance aux énergies fossiles. Les athlètes professionnels et les spectateurs de grandes rencontres font également grimper les émissions, notamment avec l’utilisation de l’avion pour les déplacements à long distance.
Par ailleurs, les infrastructures sportives, comme les stades et les terrains d’entraînement, représentent un deuxième poste d’émission avec 21 %. Leur construction, entretien et utilisation impliquent une consommation d’énergie significative. En outre, la fabrication des articles de sport contribue pour 18 % au bilan carbone. Un élément intéressant à noter est que la France achète environ 5 millions de ballons chaque année, ce qui témoigne de l’importance de cette source d’émissions.
Enfin, l’alimentation et les boissons proposées lors des matchs représentent 10 % des émissions, tandis que la gestion des déchets n’en constitue qu’1 %. Ces divers postes d’émission mettent en lumière la nécessité d’une approche holistique pour réduire l’impact environnemental des sports comme le football et le rugby.
Des initiatives pour décarboner le sport
Le rapport du Shift Project propose plusieurs pistes prometteuses pour aider le sport à s’inscrire dans un modèle plus durable. En effet, les objectifs français prévoient de diviser les émissions de gaz à effet de serre par six d’ici 2050. Les recommandations incluent notamment la révision de la mobilité autour des événements sportifs. Coupler la vente de billets avec des titres de transport en commun pourrait par exemple inciter les spectateurs à utiliser moins leur véhicule personnel. D’autres initiatives, comme le système Licence Club qui offre des réductions sur les trajets pour les supporters, pourraient également contribuer à réduire l’impact environnemental du sport.
Vers une réduction des émissions par l’innovation
Les avancées technologiques et l’innovation peuvent également jouer un rôle crucial dans la décarbonation du sport. Par exemple, améliorer l’efficacité énergétique des infrastructures sportives, en favorisant l isolation ou la construction avec des matériaux durables tels que le bois, peut considérablement diminuer l’empreinte carbone. Des initiatives ont déjà été observées, comme celle de la ville de Nice qui a réussi à réduire de 10 % les émissions liées à la construction de son stade en intégrant du bois.
Réflexions sur les événements internationaux
Les rencontres internationales, bien qu’elles représentent seulement 6 % des matchs joués dans le football ou le rugby, constituent 60 % des émissions. Ce paradoxe souligne l’importance des déplacements en avion pour de nombreux spectateurs. Il est donc crucial de repenser l’organisation de ces événements. En avançant vers un modèle qui privilégie des compétitions géographiquement structurelles, comme le système de playoffs de la NBA, on pourrait réduire significativement les trajets longs pour les équipes et les fans. Une telle approche répond non seulement à l’enjeu écologique, mais elle pourrait également améliorer le bien-être général des athlètes, qui se disent de plus en plus fatigués par des voyages épuisants.
Conclusion sur l’importance d’évaluer l’empreinte carbone
Le besoin d’évaluer régulièrement l empreinte carbone du football et du rugby est impératif pour garantir la durabilité de ces sports. Chaque acteur, qu’il soit amateur ou professionnel, peut prendre part à cette transition vers un modèle plus respectueux de l’environnement. En s’inspirant des recommandations évoquées et en mettant en œuvre des initiatives innovantes, le monde du sport peut non seulement réduire son impact environnemental, mais également promouvoir des pratiques plus durables au sein de la société dans son ensemble.

Témoignages sur l’évaluation de l’empreinte carbone du football et du rugby en France
Justine Birot, co-autrice du rapport du Shift Project, souligne l’importance des données collectées pour évaluer l’empreinte carbone des sports collectifs. Elle explique : « Grâce aux données des fédérations et des ligues, nous avons pu analyser des éléments cruciaux comme les distances parcourues pour se rendre aux entraînements et matchs. Ces informations physiques nous permettent de comprendre le bilan carbone du football et du rugby. »
Alan Lemoine, également co-auteur du rapport, partage son optimisme quant à la possibilité de décarboner ces disciplines. Il affirme : « C’est possible de réduire considérablement l’empreinte carbone du football et du rugby sans bouleverser leur mode d’organisation actuel. La mise en place de solutions durables peut nous aider à préserver ce que nous aimons dans ces sports, à savoir la santé et la convivialité. »
Il met en lumière que, malgré l’évaluation à 2,2 millions de tonnes de CO2 par an pour ces deux disciplines, il est envisageable de diviser cet impact par cinq d’ici 25 ans, en alignant les pratiques avec les objectifs de l’Accord de Paris.
Les témoignages des dirigeants de clubs de football et de rugby illustrent également la volonté d’agir. Michel Durand, président d’un club amateur, partage que « les informations sur notre empreinte carbone ont été un véritable déclic. Nous réalisons maintenant que 75 % de nos trajets se font en voiture, et nous envisageons de mettre en place des options de transport plus vertes pour nos joueurs et nos supporters. »
Dans le même esprit, Claire Dupuis, dirigeante d’une ligue de rugby, insiste sur l’importance de réévaluer l’organisation des compétitions : « Les matchs internationaux sont responsables d’une grande part de notre empreinte. Nous devons réfléchir à des solutions qui limitent les longs déplacements, tout en préservant le plaisir du jeu. »
Ces témoignages reflètent un engagement croissant au sein du sport français pour prendre en compte l’impact environnemental, avec l’espoir que des actions concrètes contribueront à un avenir plus durable. Les réflexions sur l’évolution et la durabilité du football et du rugby sont sur toutes les lèvres, et chaque acteur est appelé à participer à cette transition nécessaire.