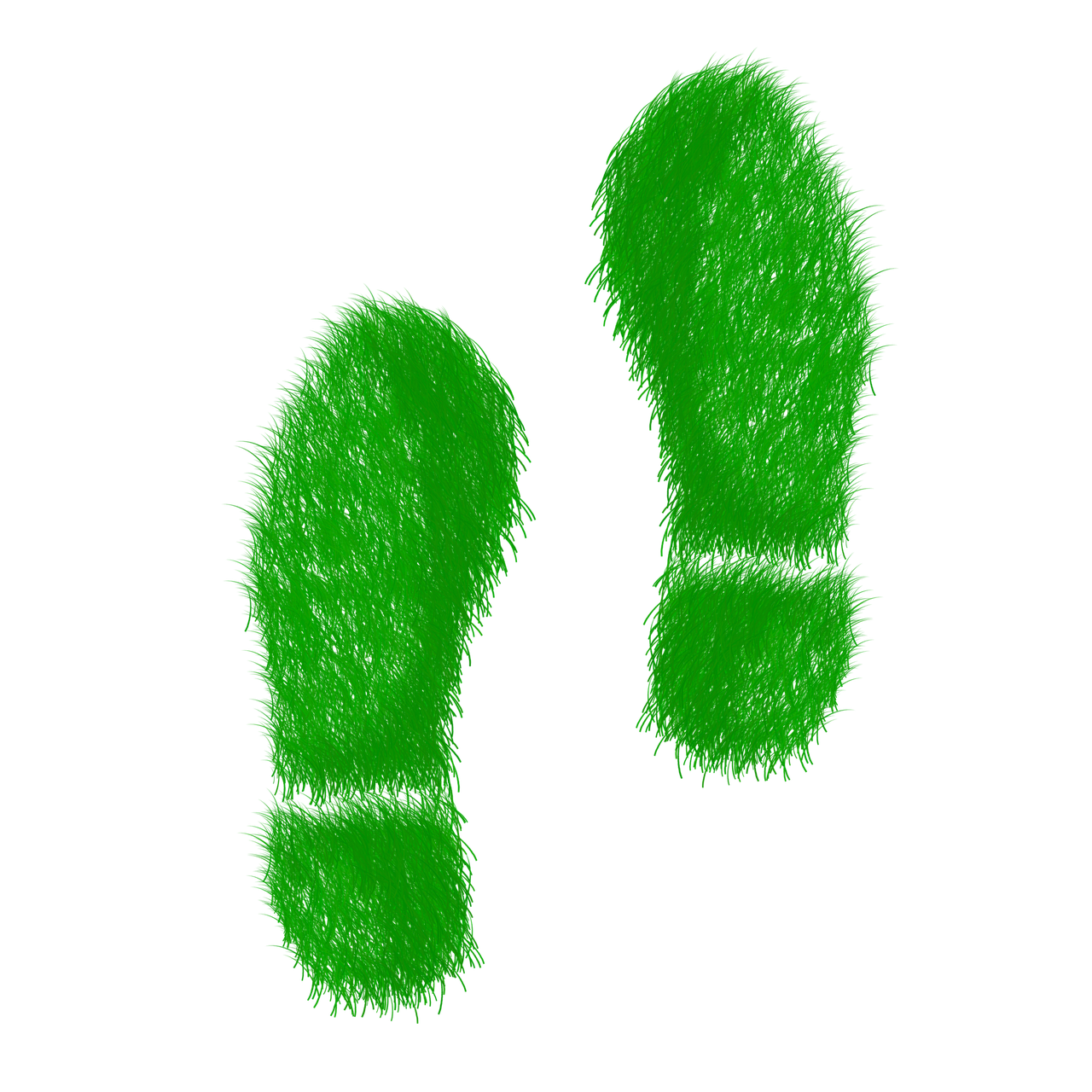|
EN BREF
|
Pour réduire son empreinte environnementale, le CNRS a mis en place plusieurs initiatives concernant ses acquisitions, principal facteur de ses émissions de gaz à effet de serre. En 2025, l’organisme a publié son premier schéma directeur de développement durable, visant à prioriser les actions sur les segments d’achats les plus impactants. Un arbre de décisions développé par l’Institut Pierre-Simon Laplace encourage les chercheurs à privilégier l’achat de matériel d’occasion, le réemploi et la réparation, plutôt que d’opter pour de nouveaux équipements. De plus, des mesures ont été instaurées, telles que l’intégration de critères environnementaux dans les marchés publics. Le CNRS explore également l’utilisation de l’analyse du cycle de vie pour évaluer l’impact environnemental de ses achats et envisage de mieux quantifier les émissions de gaz à effet de serre associées à ses équipements.
Le CNRS, en tant que premier organisme de recherche français, a pris conscience de son impact écologique à travers ses acquisitions. Face à un bilan d’émissions de gaz à effet de serre où ces entrées représentent 85 % de l’empreinte carbone, le CNRS a déployé un ensemble d’initiatives pour réduire cet impact tout en préservant la qualité des recherches scientifiques. Des actions ciblées sur l’éco-responsabilité des achats, en passant par la sensibilisation des prescripteurs et l’intégration des enjeux environnementaux dans ses pratiques, illustrent l’engagement du CNRS à évoluer vers un développement durable.
Le bilan carbone du CNRS et la nécessité d’agir
Le CNRS a réalisé son deuxième bilan des émissions de gaz à effet de serre (BEGES) fin 2024, révélant que les achats constituent le principal poste d’émissions, bien devant d’autres facteurs tels que la consommation d’énergie ou les déplacements. Les résultats de ce bilan ont poussé le CNRS à mettre en place des mesures pour diminuer son empreinte écologique. Dans cette perspective, un schéma directeur de développement durable a été publié, appelant à prioriser des actions de maîtrise sur les segments d’achats les plus impactants.
Former pour mieux acheter
Au cœur de cette stratégie, le CNRS mise sur la formation et la sensibilisation de ses prescripteurs d’achats. L’Institut Pierre-Simon Laplace (IPSL) a, par exemple, élaboré un arbre de décisions concernant les achats, qui incite les équipes à réfléchir avant de procéder à un achat. En effet, cet outil propose une série de choix allant de l’achat neuf à ceux favorisant l’achat d’occasion, la réparation ou le réemploi de matériels.
Stéphanie Boniface, chargée de mission à l’IPSL, souligne que cet arbre de décision n’est pas coercitif mais vise à encourager une réflexion utile sur l’impact de chaque achat. Avec de tels outils, le CNRS ambitionne de provoquer un changement dans la manière d’acquérir du matériel scientifique, en rendant les équipes plus conscientes des conséquences écologiques de leurs choix.
Réparation et maintenance des équipements
Un autre axe de travail du CNRS concerne la réparation et la maintenance des équipements scientifiques. Comme l’indiquent les experts, la fabrication représente la phase la plus émettrice de gaz à effet de serre lors de l’acquisition d’un instrument. En prolongeant la durée de vie des équipements par une maintenance régulière, le CNRS réduit non seulement son empreinte écologique, mais optimise également son budget.
Sébastien Turci, responsable de la direction déléguée aux achats et à l’innovation (DDAI), insiste sur l’importance d’allouer une partie du budget pour les garanties et la maintenance des équipements afin de retarder de futurs remplacements. Cela permet aux laboratoires de réaliser des économies tout en agissant sur leur impact environnemental.
Inclusion de critères environnementaux dans les marchés publics
Dès mai 2023, le CNRS a introduit un critère environnemental dans ses marchés publics, marquant ainsi un engagement fort en matière de durabilité. Ce changement a été anticipé de trois ans avant la réglementation publique en vigueur. Pour faciliter cette transition, la DDAI a mis en place un espace collaboratif où les acheteurs peuvent échanger des ressources sur la gestion environnementale de leurs achats.
Dans ce cadre, des guides, des référentiels et des clauses environnementales adaptées à chaque type de marché sont mis à la disposition des équipes. L’objectif est de rendre les prescripteurs plus efficaces dans leurs choix tout en promouvant la durabilité à chaque étape du cycle de vie d’un achat, de l’écoconception à la gestion des déchets.
Analyse du cycle de vie (ACV) comme outil stratégique
Pour évaluer précisément l’impact environnemental de ses achats, le CNRS se tourne vers l’analyse du cycle de vie (ACV). Cette méthode permet d’analyser les processus sociotechniques impliqués dans chaque achat, depuis l’extraction des matières premières jusqu’à leur traitement en fin de vie. En intégrant l’ACV dans ses achats, le CNRS progresse vers une gestion plus écologique de ses ressources.
CNRS Ingénierie, un des instituts du CNRS, a développé une unité dédiée à l’ACV, tournée vers la formalisation d’une méthode quantifiée et multicritères d’évaluation des projets de recherche. Cette approche vise à intégrer l’empreinte environnementale tout en poursuivant des objectifs de performance scientifique.
Collaboration avec d’autres organismes
Pour renforcer ses efforts, le CNRS collabore avec d’autres établissements tels que l’Inserm et l’Inrae, afin de créer des dispositifs incitatifs à la sobriété. Cela inclut le développement de bonus pour les projets qui favorisent le réemploi et la mutualisation des équipements, ainsi que l’inclusion d’une rubrique sur l’impact environnemental dans les propositions de recherche. De telles coopérations facilitent également le partage de bonnes pratiques au sein du secteur.
Intégration des enjeux environnementaux dans les pratiques de recherche
Le CNRS s’efforce d’intégrer les enjeux environnementaux dans ses pratiques de recherche, ce qui implique des ajustements dans l’évaluation des projets. Par exemple, des discussions sont en cours pour intégrer ces enjeux dans le prochain programme cadre européen. L’objectif est de faire en sorte que l’impact écologique devienne un critère de sélection déterminant.
La vision d’un avenir durable
Au fil de ces initiatives, le CNRS s’engage à la transition vers un modèle de recherche respectueux de l’environnement. Stéphane Guillot évoque une synergie entre la qualité scientifique et la réduction de l’empreinte carbone, visant à démontrer que la recherche peut être aussi performante qu’écologiquement responsable. Dans cette dynamique, des outils comme le GES 1Point5 sont utilisés pour quantifier les émissions de gaz à effet de serre résultant des achats.
Le CNRS s’intéresse à affiner son évaluation en se tournant vers des facteurs d’émissions physiques, basés sur les caractéristiques environnementales des produits. Cela vise à mieux saisir les différences d’impact entre des équipements semblables, un enjeu crucial pour maximiser la durabilité des acquisitions.
Les résultats et la voie à suivre
Les différentes initiatives mises en place par le CNRS montrent une volonté forte de réduire son impact environnemental. À travers la formation, l’intégration de critères environnementaux, l’analyse du cycle de vie ou encore la collaboration avec d’autres organismes, le CNRS établit des bases solides pour une recherche durable. Un engagement qui ne se limite pas aux discours, mais qui se matérialise par des actions concrètes et mesurables, témoignant d’une véritable volonté de changement.
Pour davantage d’informations sur les initiatives adoptées par le CNRS, vous pouvez consulter les ressources suivantes : Stratégies du CNRS, Évaluer l’empreinte carbone de l’université, et Intégrer les enjeux environnementaux.

Témoignages sur les initiatives du CNRS pour minimiser l’impact écologique de ses acquisitions
Les récentes initiatives mises en place par le CNRS en matière d’achats responsables témoignent d’un véritable engagement environnemental. Stéphanie Boniface, chargée de mission à l’Institut Pierre-Simon Laplace, souligne l’importance de l’arbre de décisions sur les achats. Elle explique : « Cet outil est incitatif, il pousse nos collègues à réfléchir sur la pertinence de leurs achats, favorisant ainsi les options de réemploi et de réparation ».
Sébastien Turci, à la tête de la direction déléguée aux achats et à l’innovation du CNRS, complète en affirmant : « En prolongeant la durée de vie des équipements par leur maintenance, nous réduisons l’empreinte environnementale tout en optimisant le budget des laboratoires ». Cette démarche montre qu’il est possible d’allier science de qualité et respect de l’environnement.
Aurore Debono, chargée d’études à la DDAI, évoque l’espace collaboratif dédié au développement durable initié dès mai 2023. Elle déclare : « Grâce à cet espace, les acheteurs peuvent partager des bonnes pratiques et des clauses environnementales adaptées, offrant ainsi une réponse concrète aux exigences écologiques ».
Myriam Saadé, directrice de l’unité d’appui consacrée à l’analyse du cycle de vie, précise que cette méthode « aide à structurer les chaînes de production, en favorisant les technologies moins émissives ». Cela illustre comment l’utilisation de l’ACV permet d’allier performance scientifique et responsabilité écologique.
Enfin, Stéphane Guillot, délégué scientifique au développement durable, se montre optimiste quant à l’avenir. « Nous pouvons réaliser une recherche de haut niveau tout en maîtrisant notre impact carbone », affirme-t-il. Cette conviction reflète l’objectif clair du CNRS : concilier exigence scientifique et respect des enjeux environnementaux.