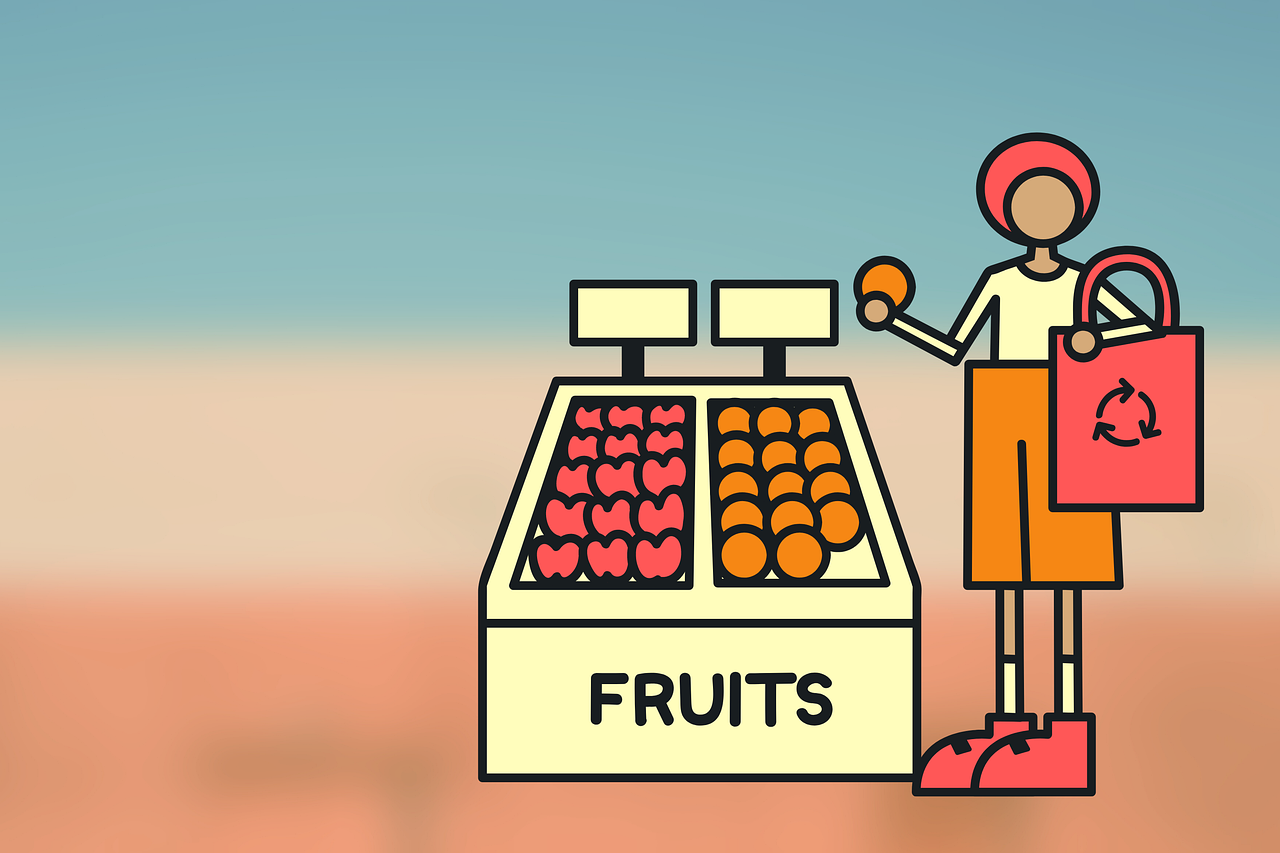|
EN BREF
|
Un musée français émet en moyenne 9000 tonnes de CO2 par an, ce qui représente un enjeu majeur dans le cadre de la transition écologique des établissements culturels. La crise sanitaire liée au Covid-19 a amplifié les préoccupations environnementales au sein des musées, incitant de nombreuses institutions à reconsidérer leurs pratiques. Le rapport Décarbonons la culture a mis en lumière la vulnérabilité des musées face aux crises énergétiques et climatiques. Des initiatives, comme celles des musées de société, qui ont pris les devants en matière de décarbonation, témoignent d’un virage nécessaire vers des modèles plus durables. Une mobilisation accrue s’opère également au sein des musées d’art, contribuant ainsi à une prise de conscience collective sur l’urgence de réduire l’empreinte environnementale du secteur culturel.
Un musée français consomme l’équivalent de 9000 tonnes de CO2 par an : un enjeu crucial pour la transition écologique des établissements culturels
La transition écologique des musées français est devenue une question prioritaire à la lumière des enjeux environnementaux contemporains. En moyenne, un grand musée en France produit environ 9000 tonnes de CO2 annuellement. Cette situation préoccupante souligne l’urgence d’adopter des mesures concrètes pour réduire leur empreinte carbone et promouvoir des pratiques durables au sein du secteur culturel. Dans cet article, nous explorerons l’état actuel des musées, les initiatives en cours pour amorcer ce virage, ainsi que les implications d’une transition nécessaire pour l’avenir de ces institutions.
Le constat alarmant : des musées émetteurs de CO2
Les musées français, en tant qu’institutions culturelles, sont souvent perçus comme des espaces de conservation et de valorisation de l’art et du patrimoine. Toutefois, ils se révèlent également être des sources significatives d’émission de CO2. Selon des études, un grand musée émet en moyenne 9000 tonnes de CO2 par an, une empreinte carbone équivalente à celle de plusieurs centaines de ménages français. Cette situation interpelle et nécessite une remise en question des pratiques actuelles au sein des établissements.
Les raisons de cette consommation élevée
Plusieurs facteurs contribuent à cette consommation énergétique. Tout d’abord, la climatisation et le chauffage des espaces d’exposition, indispensables pour la conservation des œuvres, entraînent une forte consommation d’énergie. De plus, l’organisation d’expositions temporaires, souvent marquées par des prêts d’œuvres à travers le monde, engendre des déplacements de pièces fragiles nécessitant des transports polluants. Les éclairages, les systèmes de sécurité et l’entretien quotidien des bâtiments ajoutent également à cette empreinte écologique. En somme, plusieurs éléments du fonctionnement muséal participent à ce constat préoccupant.
Une prise de conscience collective au sein du secteur culturel
Face aux données alarmantes sur les émissions de CO2, le secteur culturel français a commencé à prendre conscience de sa responsabilité écologique. Comme l’indique Aude Porcedda, muséologue et sociologue, la pandémie de Covid-19 a fait exploser les discussions autour des enjeux environnementaux, entraînant un changement de paradigme au sein des musées. La publication du rapport Décarbonons la culture à la fin de 2021 a constitué un véritable déclencheur, révélant la vulnérabilité des institutions culturelles face aux futurs chocs énergétiques et climatiques.
Des initiatives naissantes
À la suite de cette prise de conscience, plusieurs musées commencent à mettre en place des mesures de réduction de leur empreinte carbone. Parmi ceux-ci, le musée du Quai Branly-Jacques Chirac, qui depuis sa création en 2006, s’est engagé à lutter contre le gaspillage des ressources. De même, Universcience, institution regroupant la Cité des sciences et la Cité des enfants, s’est concernée par la question de l’éco-conception et a publié plusieurs guides pratiques pour aider les établissements à se conformer à des normes environnementales plus strictes.
Enjeux politiques et réglementaires
La mobilisation du ministère de la Culture a également été cruciale. En automne 2023, ce dernier a publié un Guide d’orientation et d’inspiration pour accompagner les musées dans leur transition écologique. Ce guide fixe des objectifs concrets, comme la réalisation d’un bilan carbone pour chaque musée national, ainsi que la mise en avant de critères environnementaux dans le cadre des aides financières. Une véritable feuille de route est ainsi tracée pour que chaque établissement puisse agir en faveur de l’environnement.
Un soutien financier accru
Des fonds significatifs ont été alloués pour soutenir ces initiatives. L’appel à projets “Alternatives vertes” a été doté de 25 millions d’euros, tandis que 40 millions supplémentaires seront mobilisés pour la rénovation énergétique des musées d’ici 2024. Ces financements visent à inciter chaque institution à investir dans des pratiques plus durables, allant des rénovations de bâtiments à la réduction de leur consommation d’énergie.
Réflexions sur les modèles d’exposition
Un des enjeux majeurs de cette transition concerne la réévaluation des modèles d’exposition. Emmanuel Marcovitch, ex-directeur général délégué de la Réunion des Musées nationaux-Grand Palais, a mis en avant la nécessité de repenser les scénographies et de minimiser les surfaces d’exposition. Un changement complet du modèle est préconisé, avec une approche plaçant la durabilité au cœur des préoccupations artistiques.
L’impact des musées d’art
Traditionnellement, les musées d’art n’étaient pas particulièrement concernés par ces questions. Cependant, la crise sanitaire a poussé des institutions telles que le palais des Beaux-Arts de Lille à s’impliquer activement dans la lutte contre les émissions de CO2. Le musée a adapté sa politique de développement durable pour minimiser les impacts environnementaux, notamment en limitant le nombre d’expositions temporaires aux interdits les années impaires et en favorisant les œuvres de sa collection permanente pour réduire les transports polluants.
Les écomusées et la transition précoce
Les écomusées français, nés dans les années 1960 et 1970, ont souvent été des précurseurs en matière de transition écologique. Ces structures, qui privilégient la relation entre l’homme et son environnement, intègrent la notion de sobriété dans leur fonctionnement quotidien. La dimension d’engagement envers l’environnement est essentielle à leur mission, offrant un modèle à suivre pour les autres musées.
Un partenariat avec les acteurs locaux
Les musées doivent également établir des partenariats avec des acteurs locaux pour renforcer leur engagement environnemental. La collaboration avec des organisations œuvrant pour le développement durable, comme la Fondation Engage, peut aider à réduire l’impact des expositions tout en favorisant des synergies positives. Ce type de démarche permet de transformer le musée en un acteur de changement au sein de sa communauté.
La nécessité d’une culture de transition
Pour que les changements souhaités soient durables, il est essentiel que la transition écologique des musées s’accompagne d’un véritable changement culturel. Anaïs Roesch de The Shift Project rappelle que cette transition ne se limite pas à des aspects techniques, mais doit également inclure un questionnement plus large sur nos comportements et valeurs sociétales. La réflexion autour des modes de vie doit s’intensifier pour favoriser une culture des transitions que tous peuvent embrasser.
Sensibilisation et éducation
Les musées peuvent jouer un rôle central dans la sensibilisation du public aux enjeux environnementaux. En intégrant des thèmes tels que le changement climatique dans leurs expositions et en organisant des ateliers participatifs, ils peuvent éveiller les consciences et inciter les visiteurs à adopter des comportements plus respectueux de l’environnement. Les initiatives telles que “Urgence climatique”, une exposition permanente à la Cité des sciences, montrent déjà la voie à suivre.
Les actions en cours dans les musées à l’international
Au niveau international, des musées comme le musée d’Ethnographie de Genève ont pris des mesures significatives pour réduire leur empreinte carbone. Ce musée a été le premier en Europe à obtenir le label international Très Haute Qualité Sanitaire, Sociale et Environnementale (THQSE), témoignant de son engagement pour une durabilité réelle. Aux États-Unis, le Baltimore Museum of Arts a également lancé un ambitieux programme environnemental intitulé “Turn again to the Earth”, promettant d’intégrer le développement durable dans sa stratégie globale.
Les leçons à tirer de l’international
Les initiatives étrangères soulignent l’importance de partager les bonnes pratiques en matière d’écologie muséale. Le travail collaboratif entre musées permet de tirer profit des expériences réussies et de surmonter les défis communs. Les établissements français ont tout à gagner à observer ces démarches et à adapter des solutions innovantes pour leur propre contexte.
La voie vers une transition réussie
Pour que la transition écologique des musées soit réussie, il est crucial d’adopter une approche multi-niveaux englobant les efforts individuels des institutions, les changements structurels nécessaires et l’impulsion politique. La publicité et la communication autour des projets durables sont également des éléments essentiels pour garantir que ces initiatives soient reconnues et soutenues par le public.
Un appel à l’action collective
Enfin, le passage à un modèle plus durable ne peut se faire que grâce à un appel à l’action collective. Musées, gouvernements, collectivités locales et citoyens doivent unir leurs forces pour faire en sorte que les musées deviennent des modèles de durabilité et d’engagement environnemental. Alors que les défis climatiques sont de plus en plus pressants, chaque acteur de la culture a un rôle à jouer pour construire un avenir respectueux de l’écologie.

Un musée français consomme l’équivalent de 9000 tonnes de CO2 par an : un enjeu crucial pour la transition écologique des établissements culturels
La transition écologique des musées français est plus que jamais d’actualité. Si l’on considère qu’un grand musée émet en moyenne 9000 tonnes de CO2 par an, il devient urgent d’agir. Le rapport Décarbonons la culture a révélé la vulnérabilité de ces institutions face aux enjeux climatiques, provoquant une prise de conscience nécessaire au sein du milieu culturel.
« La crise sanitaire a mis en lumière les défis environnementaux que nous devons surmonter », explique Aude Porcedda, muséologue et sociologue. « À peine une poignée de musées s’intéressait à ces questions avant 2020, mais aujourd’hui, il est impératif que chaque acteur du secteur prenne ses responsabilités. » Cette nouvelle conscience collective est peu à peu intégrée dans le fonctionnement quotidien des établissements.
Des musées tels que le musée du Quai Branly-Jacques Chirac ont déjà pris des mesures depuis plusieurs années pour réduire leur empreinte écologique. « Nous avons compris que notre rôle dépasse la simple exposition d’œuvres d’art. Il s’agit également de protéger les cultures menacées en agissant sur notre impact environnemental », témoigne un responsable du musée.
Dans d’autres institutions comme le Palais des Beaux-Arts de Lille, un véritable changement de paradigme s’opère. « Nous avons décidé de revoir notre politique d’expositions en adoptant un modèle plus durable. Cela signifie moins de grosses expositions et un focus sur nos collections permanentes », déclare la directrice. Cette approche pragmatique permet non seulement de limiter les transports polluants mais également de préserver les ressources.
Les écomusées, quant à eux, ont un long historique d’engagement envers la durabilité. « Dès leur création, nous avons intégré des principes de sobriété et d’économie de moyens dans nos pratiques », affirme Céline Chanas, présidente de la Fédération des écomusées. « Nous avons toujours eu à cœur de sensibiliser notre public à la relation entre l’homme et son environnement. » Cela témoigne de l’importance des fondations sur lesquelles ces institutions se reposent.
Avec le soutien accru du ministère de la Culture, les musées sont désormais appelés à réaliser un bilan carbone. « Avoir les moyens financiers pour la transition est essentiel. Nous avons été ravis d’apprendre que le ministère débloquait des fonds pour accompagner nos initiatives », assure un gérant d’établissement. Ce soutien institutionnel marque une nouvelle ère pour les musées français, les encourageant à s’engager dans une démarche écoresponsable.
À l’étranger, certains musées ouvrent la voie, comme le musée d’Ethnographie de Genève, reconnu pour sa démarche exemplaire en matière de développement durable. « Nous inspirons d’autres établissements à suivre cette voie », estime un représentant de musée. Les échanges entre les musées nationaux et ceux à l’international sont cruciaux pour réfléchir ensemble à des solutions durables.